Gabriel Garcia Marquez, Chronique d'une mort annoncée
Référence : Gabriel Garcia Marquez, Chronique d'une mort annoncée, éditions Grasset, traduction Claude Couffon, 210 pages, décembre 1981
Incipit : « Le jour où il allait être abattu, Santiago Nasar s'était levé à cinq heures et demie du matin pour attendre le bateau sur lequel l'évêque arrivait. »

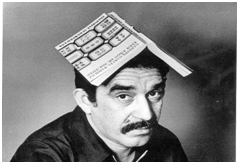
Garcia Marquez en 1984
Le narrateur [1] revient plusieurs années après, sur le meurtre de son ami Santiago Nasar dans un village colombien en recueillant des témoignages sur cet événement qui avait bouleversé la communauté.
Tout part du mariage de Bayardo San Roman et d'Angela Vicario. Le marié est furieux parce qu'il s'est aperçu pendant la nuit de noces qu'Angela n'est plus vierge. Avant de la renvoyer dans sa famille, il lui arrache le nom du coupable : Santiago Nasar.



Dans la mentalité de ces gens, les deux frères jumeaux d'Angela, les jumeaux Pedro et Pablo se doivent de venger l'honneur de leur sœur. Munis de couteaux, ils se planquent dans une boutique qui fait face à la maison de Santiago, à l'affût devant une sortie qu'il utilise peu et ne cachent pas leur intention : tuer Santiago car : « il sait pourquoi ».
« Les affaires d'honneur sont des cases hermétiques auxquelles ont seuls accès les maîtres du drame. »
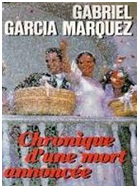
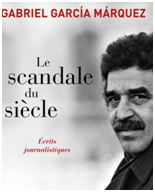

Mais on ne les prend pas au sérieux. N'ayant que des soupçons, la police se contente de confisquer les couteaux, sans avertir Santiago du danger. Tout le village est au courant sauf Santiago et sa mère, et les jumeaux se procurent sans problème d'autres couteaux.
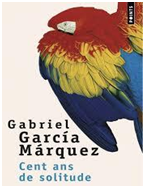


Le village est tout occupé à la venue de l'évêque qui, sur le fleuve, passe rapidement devant le village en leur donnant sa bénédiction. Alors qu'il s'apprête à repartir chez lui, Santiago est tué devant la porte qu'il utilise peu et que sa mère vient de fermer.
Les assassins feront trois ans en prison, finalement acquittés ayant agi pour venger l'honneur de leur sœur. Selon des témoins, les deux frères ont tenté en vain de se soustraire à cette obligation mais personne ne les a crus. Même si Angela a confirmé ses accusations, le narrateur en doute fortement. Toujours est-il que plus tard, Bayardo et Angela renoueront pour finir par vivre ensemble.


Gabo & sa femme à Paris en 1981 Gabo et François Mitterrand
« Jamais une mort ne fut plus annoncée »
Sur le contenu, on peut dire que le livre a un côté roman policier. On ne sait trop si Santiago est réellement "coupable" d'avoir déshonnoré Angela, ne serait-ce que parce que la jeune fille reste constamment sous le regard des membres de sa famille et ses frères, qui semblent douter de la réalité des faits, finalement pas si sûrs de leur bon droit. Santiago lui-même ne s'inquiète pas du danger, continuant de vivre comme s'il était innocent.

Dans cette logique, il faut se demander pourquoi cette accusation de la part d'Angela et quelles étaient les relations entre Santiago et Angela. Le jeune homme aurait repoussé Angela, ne la jugeant pas digne de lui et ayant suscité en elle un profond sentiment de vengeance.
Cette reconstitution n'explique rien, et même rend plutôt opaque les faits et motivations de chacun. On retrouve bien ici ses thèmes favoris de l'honneur et de la fatalité magnifiés par l'imagination et l'humour de l'auteur.


Marquez en fait une histoire sur la question de la réalité du viol vérité dont la fin n'est pas dévoilée. Il divise son roman en cinq blocs, visant un moment précis du meurtre et des gens impliqués et posant le problème de savoir pourquoi ce meurtre a pu se perpétrer si tout le monde savait et que personne n'a essayé de l'empêcher.
On y trouve aussi quelques références au réalisme magique si cher à Marquez, comme dans l'odeur de la mort que Santiago laisse chez ses assassins, la couleur bleue de l'âme d'une voisine, Yolanda de Xius ou la "présence" d'un oiseau fluorescent qui, comme une âme en peine, survole l'église du village.


Ornella Muti dans le film éponyme Garcia Marquez en octobre 1992
Complément
D'après un événement qui s'est déroulé le 20 janvier 1951 dans la ville côtière de Manaure en Colombie, "Gabo" comme on le surnommait revient sur le meurtre de Cayetano Gentile, accusé d'avoir violé Margarita Chicha Salas, l'Angela Vicario du roman. Margarita aurait été rejetée par Miguel Reyes Palencia, le Bayardo du roman.


Manauré, ville où s'est passé l'événement
Notes et références
[1] Le narrateur, dont on ne connaît pas le nom, est le cousin d'Angela et un ami proche de Santiago.
Voir aussi :
